Morceaux choisis :
– Présences à Port-des-Prés
– Extrême-automne
– Pigeons
– Adieu à une route morte
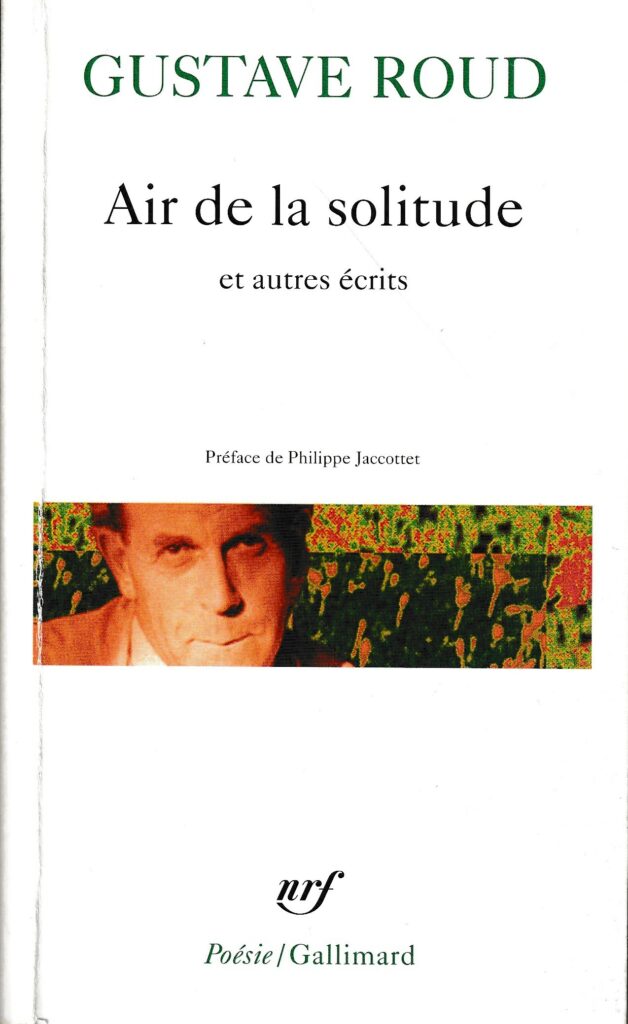
- Présences à Port-des-Prés
Ce texte raconte les « absents » entrevus lors de « visions », assis sur un banc. À la suite les uns des autres, Roud convoque ceux que sa mémoire « remonte » :
« Alors, presque tout de suite, c’est toi. Comme tu reprends vie, comme tu t’installes d’un bond dans ta brutale pureté ! Tout à l’heure tu n’étais encore qu’un froissement de fleurs et d’herbes, un corps vague traversé de feuilles, de hautes graminées, et ta faux a glissé dans le bassin sans un éclair. Mais déjà, tes vraies lèvres d’homme brisent le bras d’eau brillante, deux bras de chair plongent jusqu’à l’épaule dans la fraîcheur. Une ombre t’est rendue. »
« Une ombre t’est rendue. »
Il me vient à l’esprit l’image des miniatures des livres d’heures du Moyen-Age et les premiers enlumineurs qui, dessinant de simples paysans occupés à des tâches agricoles devant les murs du château, ont commencé à leur ajouter une ombre. Il s’agissait sans doute de mieux les inscrire dans le paysage en donnant une perspective, mais aussi -et je ne sais pas si les peintres en étaient conscients- une présence plus marquée. La scène acquiert ainsi et de la profondeur et de la vie : l’illusion peut s’animer. Dans cette vision de Roud, cette « ombre rendue » vient combler ce qui manquait peut-être à l’absent afin de lui donner « vie ».
Le banc se vide, le réel reprend ses droits, mais Roud sait de quoi il se compose :
«Nul besoin de tourner mes regards vers les prés : je sens soudain le soleil sur la matinée déjà flétrie, je vois, les yeux clos, un cheval là-bas redresser brusquement la tête, arrachant à l’andain des touffes de tiges tendres, les garçons piquer de la fourche sombre le trèfle tranché. Je sais qu’ils rient, comme tu riais jadis… »
Il souhaite néanmoins renouer avec sa vision de l’absent, des absents :
« Ô qu’un peu de repos encore me soit donné sur ce mince banc de bois rêche, ce pont nul entre deux mondes, ce rivage battu tour à tour du temps et de l’éternité. Que je demeure immobile encore, l’oreille ouverte au double abîme, une main tendue à ceux qui savent et qu’un seul battement de nos cœurs arrache à l’éternel, de l’autre cherchant en vain sous la houle temporelle, comme un plongeur aveugle, à saisir ceux qui s’appellent eux-mêmes les vivants. »
Un jour peut-être, l’un d’eux « hanté lui aussi par l’anxieux appel des voix sans lèvres », viendra s’asseoir à ses côtés :
« Et tous deux nous verrons enfin ce que j’ai vu : l’instant d’extase indicible où le temps s’arrête, où le chemin, les arbres, tout est saisi par l’éternité. »
- Extrême-automne
Roud, infatigable arpenteur, décrit dans ce texte le pays du Haut-Jorat à la fin de l’automne et les hommes qui l’habitent. Sa vision où se mêlent présent et passé, semble associer peinture et photographie, éclair vivace du souvenir et tendresse infinie pour ces paysages.
« Hier encore […]. À la pointe du dernier sillon, Fernand, l’épaule nue et dorée comme au plein de l’été, une main sur le soc éblouissant, portait de l’autre à ses lèvres une pomme si rouge que le ciel autour d’elle avivait son bleu trop doux.
Les chevaux las s’endormaient au repos et leurs crinières, en se penchant vers le sommeil, démasquaient par à-coups le ruban d’horizon, ses pans de collines, ses villages minuscules délicatement dessinés, avec le compte exact des toitures et des arbres, leurs couleurs posées côte à côte sans une bavure, à peine amorties au fond de l’air mûri comme un vin d’or. »
Un basculement s’opère cependant vers la morte saison, la fin de ces heures glorieuses. L’extrême-automne se meurt. Gustave Roud, impuissant, ne peut l’empêcher.
« Là-bas, aux vergers presque déserts, on fait tomber les dernières pommes, ces petites pommes douces qui seront broyées. L’arbre tremble, la grêle des fruits martèle le gazon avec ce bruit que l’on reconnaît entre mille, un bref battement de tambour amorti, et l’oblique essaim des feuilles hésite et se pose comme une troupe d’oiseaux. »
« On voit passer aux routes de hauts chars de gerbes mortes, comme un trésor d’été devenu cendre sous le soleil sans pouvoir. Et voici monter de la vallée, par grandes vagues blêmes et sournoises où s’effondre sans bruit le paysage, colline après colline, village après village, labour après labour, le dévoreur de lampes et d’étoiles, le perfide seigneur d’extrême-automne, le brouillard. »
- Pigeons
On imagine Gustave Roud, absorbé, à sa table de travail dans sa maison de Carrouge, ou méditant, regardant par la fenêtre, distrait par l’arrivée d’un petit garçon portant un lourd panier d’osier, laissant entrer avec lui le froid d’une sombre journée de janvier. Dans le panier, deux jeunes pigeons, cadeau d’Aimé :
« Les deux pigeons sont là dans le grand panier gris et rose. Est-ce qu’il faudra vraiment les tuer, cher Aimé ? Je n’en ai jamais reçu, comment faut-il faire ? »
Il connaît la mort des animaux domestiques, celle que l’on donne dans les campagnes, mais là, « C’est une nouvelle espèce de mort et qui s’en chargera ?… » Il connaît aussi ce genre de panier : « il est beau et lourd », on y fait rouler les pommes, en octobre…
Cependant, il se remet à sa table de travail et se met à écrire :
« Tout cela, j’aurais dû monter vers toi pour te le dire. Le chemin n’est pas si long qui nous sépare. »
La peur l’a retenu de le faire :
« La peur de tout un univers mort qui est entre nous et qu’il faudrait écarter comme un cadavre. Un chemin mort sous un ciel mort. Un pays noir, un pays blanc, hier rigide encore et mollissant aujourd’hui déjà… »
Il ne peut traverser « ce lieu où se mêlent l’être et le non-être. » Il sait pourtant ce dont il se prive : « Je ne verrai pas ces travaux d’hiver si jolis à voir faire dans leur monotonie qui est celle qui convient à un passe-temps. » Des images l’assaillent. Celle du corps d’Aimé, occupé à tresser des liens de gerbes :
« Près d’une étroite fenêtre d’écurie, une moitié du corps durement cernée de lumière, l’autre confondue avec l’ombre où luit doucement la paille dénouée et tordue comme une chevelure, tu es assis, les poings refermés sur la tresse rêche qu’on tord et tire. »
Il imagine : si le soleil se fait plus fort, touchant « cette paille et lui [rendant] sa couleur d’août , voici renaître dans le noir tout un après-midi de moisson dans son odeur de sueur et de paille chaude.» Cette vision l’obsède et, pour en être soulagé, il se dit qu’il faudrait s’inscrire dans le « faire » : « il faudrait tenter une chance par l’objet, comme toi (Aimé) tordre des liens ou tresser des corbeilles. »
On imagine, Gustave Roud, levant les yeux de ce qu’il vient d’écrire. Des enfants passent dans la rue, l’école est finie. Des pigeons vont se poser devant le seuil de sa maison, « c’est l’heure du grain ».
Les deux siens « sont toujours là, côte à côte, serrés contre la tresse d’osier nu. » Il les caresse et nous dit : « On dirait qu’eux aussi ils attendent – mais quoi ?
- Adieu à une route morte
« Thévoz, tu le sais, toi aussi : cette procession de peupliers solennels, cette double file de vivantes colonnes vertigineuses qui guidait le voyageur vers ton village et ta maison, ils l’ont jetée à bas…[…] Il n’y a plus, entre les berges de gazon, qu’une route sans accueil, pâle et dure sous trop de soleil comme une rivière que le gel a saisie – un chemin mort. »
Gustave Roud, familier des lieux, prend à témoin un ami absent : les grands arbres qui bordaient la route ont été coupés, dépecés, emportés. Avec eux, toute une mémoire faite de moments précieux, uniques :
« Ces arbres à l’instant de mourir se souvenaient-ils peut-être de l’adolescent qui les avait aimés et les caressait jadis avant de s’adosser pour une heure d’ombre à leurs troncs fraternels ? […] (Ils) se rappelaient notre amitié… »
Au-delà de la douleur réelle de la perte de beaux arbres et celle due au « massacre » du paysage, Gustave Roud ressent un abîme intérieur :
« Cette route qui dormait en moi pour toujours n’est plus sûre. Elle se dénude comme l’autre. Les troncs chancellent, touchés à leur tour. Ce n’est plus le vent d’autrefois qui balançait innocemment les cimes contre les nuages d’été bruns et roses. Le frémissement sans fin des feuillages devient fièvre et mortel frisson de choses condamnées. Le temps va reprendre ses dons. »
La mort, pourtant, était « inscrite » dans ce Jorat où le printemps est si long à venir :
« La vallée où j’avançais parmi les coups d’épaule transparents de la bise gisait à demi-morte elle-aussi sous le ciel clos, vert-de-grisée, violâtre, avec les taches blêmes des tombes de village en village, aigre au regard comme à la gorge un vin qui tourne, une prunelle des haies avant le gel. »
À cette route, il faut lui dire adieu, comme à une morte puisque nous n’y passerons jamais plus. Jamais plus. À cet implacable destinée entraînant les êtres et les choses dans le néant, Roud oppose une fragile et puissante espérance :
« Mais n’y a-t-il pas au plus profond de notre cœur, comme une source têtue et timide hors des ruines mêmes de la mémoire, cette voix un souffle à peine qui nous annonce la fin du Temps et que toutes ces choses très aimées abolies un instant par la mort illusoire, nos yeux enfin rouverts les verront renaître une à une dans leur toute-présence, le Jour venu -quand il n’y aura plus de jours ? »
Laisser un commentaire